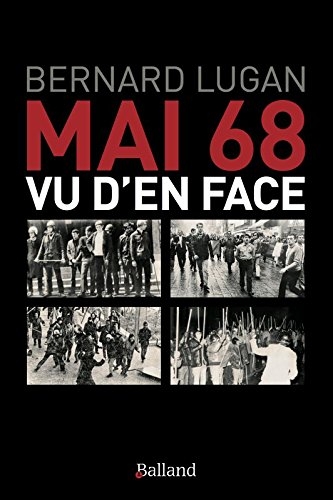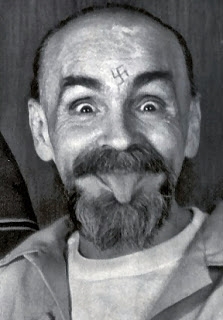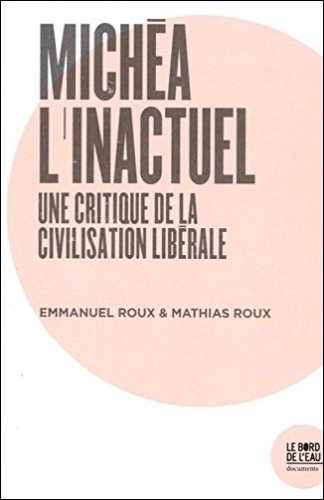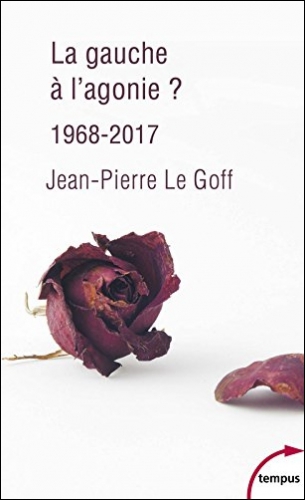L’utopie totalitaire de la Silicon Valley
Au rêve californien des hippies a succédé l’utopie technolibertarienne diffusée par les gourous de la Silicon Valley. Incontestablement séduisante, la promesse d’une humanité formée d’individus connectés aux choses et aux êtres repose en fait sur l’exploitation de nouvelles classes ouvrières et nous entraîne vers un totalitarisme doux, qui privera l’homme de sa liberté essentielle. Ce mouvement paraît irrésistible. Est-il possible de s’y opposer ?
Cinquante ans après la grande vague contestataire qui s’épanouit aux Etats-Unis à la fin des années soixante et qui explose en mai 1968 dans notre pays, on voit que les ruses de l’histoire furent cruelles pour ceux qui avaient cru aux « grands récits ». Beaucoup attendaient la révolution, mais ce fut en France comme ailleurs « l’été de la Saint-Martin » du marxisme selon la formule de Maurice Clavel. Puis on assista à la jonction de l’esprit libertaire et de l’idéologie libérale dans un capitalisme renouvelé, toujours plus radical et dominateur. Certains s’en étonnent encore mais nous n’avons plus le loisir d’y revenir car nous sommes maintenant confrontés à une rencontre fusionnelle entre les nouvelles technologies et l’utopie libertaire. Il en résulte un processus qui est en train de bouleverser les rapports entre les hommes, et les rapports entre les hommes et le monde.
Ecrivain et philosophe, Eric Sadin fait magistralement l’histoire de ces mutations dans un livre (1) qui prolonge sa remarquable « critique de la raison numérique » (2). Cette histoire commence et se poursuit en Californie, ce qui ne saurait guère étonner les lecteurs de Lucien Sfez qui nous avait expliqué que les Etats-Unis sont le pays de l’utopie technicienne (3). La Californie des Sixties avait conquis l’Amérique. C’est maintenant la Silicon Valley qui est en train de conquérir le monde en réalisant le vieux rêve soixante-huitard : changer la vie. Ce changement est rendu possible par le développement prodigieux de nouvelles technologies : accumulation massive de données, générales puis personnelles grâce aux traces laissées sur Internet ; avènement des réseaux sociaux en ligne dans l’esprit communautaire de la contre-culture des années soixante ; puis développement de « l’administration robotisée des choses » et, à partir de 2007 avec la diffusion des téléphones intelligents, progression fulgurante des services à la personnes sous forme d’applications inventées par des startups.
Sous l’égide de Google, Microsoft, Amazon et autres géants étatsuniens, nous avons l’impression que la vie sera de plus en plus facile et passionnante : nous participons désormais à toutes sortes d’échanges planétaires grâce à des techniques ludiques conçues par les bons génies de la Silicon Valley. Cette impression, largement partagée dans les sociétés modernes, favorise la croissance de l’écosystème numérique mais elle ne procède pas d’observations spontanées. Nous ne faisons que reprendre les formules d’un nouveau Grand Récit fort bien décortiqué par Eric Sadin. A l’origine, en 1938, il y a la création par William H. Hewlett et David Packard d’un audio-oscillateur dans un garage de Palo Alto. Tel est le geste de la rébellion originelle. Quant au garage, il devient le mythe fondateur de la création d’un prototype par des aventuriers du capitalisme. Ces individus géniaux développent leur propre vision, qui est en rupture avec le cadre industriel existant – mais en harmonie avec le rêve américain de la réalisation de soi-même par l’effort.
Dans les années soixante-dix, la Silicon Valley fut le théâtre de débats entre deux philosophies de la technique : l’une rationaliste, centralisée et fonctionnaliste, l’autre souple et émancipatrice dans la ligne de la sociologie contestataire. En 1972, Steward Brands, fondateur de l’une des plus anciennes communautés virtuelles, décrit l’ordinateur comme un nouveau LSD et explique que cette machine est fabriquée par des révolutionnaires qui veulent « désinstitutionnaliser la société et donner le pouvoir aux individus ». On voit alors apparaître la figure de l’entrepreneur libertaire qui se présente comme un génie visionnaire dont la puissance inventive va libérer l’humanité. Avec Steve Jobs et Apple, c’est cependant le thème de la créativité individuelle qui domina dans les années quatre-vingt mais, au tournant du siècle, la perspective de l’interconnexion générale se fit sous la double impulsion libertaire et libérale : grâce aux réseaux, on allait enfin connaître la fin de l’histoire et l’harmonie universelle ! Dix ans plus tard, l’utopie culturelle de l’émancipation par les réseaux fait place à place à une nouvelle utopie, économique et financière : « la duplication numérique du monde, écrit Eric Sadin, a fait émerger un horizon de profits intarissables qui, sous le couvert des bonnes intentions déclarées visant à améliorer le sort de l’humanité, excite toutes sortes de convoitises et de désirs ».
Le modèle de la Silicon Valley est devenu mondial. Tous les pays cherchent à imiter le système industriel et financier californien – de l’Amérique latine à la Chine en passant par l’Europe. Emmanuel Macron est manifestement happé par cette silicolonisation à base de startups inventives et de magiciens de l’intelligence artificielle. Ce nouveau monde n’est pas soumis à des processus techniques irrésistibles. Toute technique est une techno-logie : un discours qui porte une vision générale de l’homme et du monde, idéologique ou utopique (4). L’esprit de la Silicon Valley, tel que l’analyse Eric Sadin, mêle l’idée américaine de la perfectibilité infinie de l’homme, l’apologie de la rationalité scientifique qui serait capable de résoudre toutes les anomalies sociales et toutes les erreurs de jugement individuelles et le culte libertarien de l’individu qui s’auto-réalise hors de toute hiérarchie. Paradoxalement, l’intelligence artificielle vise à éliminer l’humain qui pèche par inattention, qui fait des erreurs de calcul, qui a des croyances inadéquates. Avec l’ordinateur, les fautes d’orthographe sont réparées, avec la voiture Google sans chauffeur il n’y a plus d’accidents… mais ces éléments positifs portent en eux la négation de l’être humain. L’homme est dépossédé de sa faculté de juger par une machine qui sait mieux que lui comment interpréter le monde et comment s’y conformer pour en tirer le maximum de plaisirs.
L’utopie technolibertarienne nie la liberté humaine et récuse le politique en tant que tel. Elle est tout à fait compatible avec les délires du transhumanisme mais contredit très concrètement l’exigence de justice sociale. La diffusion du modèle californien a brisé le rêve d’une démocratie accomplie, étrangère à toute hiérarchie. La Silicon Valley mondialisée, c’est une société de castes ainsi décrites par Eric Sadin :
Tout en haut l’élite des mathématiciens – king coders – qui conçoivent les algorithmes complexes. Souvent venus de pays pauvres, ils sont devenus riches et vivent hors de tout lien territorial.
Au milieu, les programmeurs qui tapent du code et surveillent les machines, les spécialistes de la finance, des relations publiques, de la mercatique… Les membres de cette caste vivent confortablement et sont fiers de contribuer au bien-être de l’humanité – sans comprendre que leurs capacités sont exploitées avec un parfait cynisme mais dans une excellente ambiance.
Tout en bas, les innombrables ouvriers, souvent asiatiques, des usines d’assemblage des ordinateurs et des téléphones qui travaillent comme des robots en inhalant des produits toxiques.
Ailleurs, éparpillés et eux aussi surexploités, les entrepreneurs individuels qui conduisent les taxis ou louent leur appartement : ils sont soumis aux algorithmes qui gèrent la plateforme – Uber, Rbnb – en assumant tous les coûts et risques de leur activité.
On dit que les travailleurs des deux dernières catégories ont au moins la chance d’avoir un travail mais ils seront un jour ou l’autre remplacés par des robots. Eric Sadin évoque la « sauvagerie entrepreneuriale » et la « criminalité en sweat-shirt » qui règne dans les grandes compagnies dont nous utilisons chaque jour les produits et qui sont dirigées par des gourous qui apparaissent comme de géniaux et sympathiques bienfaiteurs. En fait, ils cachent sous leurs allures décontractées la volonté pathologique de dominer totalement le cours des choses et la vie d’êtres humains devenus parfaitement transparents. Se dessine un totalitarisme doux, dans lequel le guide suprême sera remplacé par des opérations mathématiques dictant les choix individuels et contre lesquelles il serait absurde de se révolter.
La mise à mort de l’homme par la technologie libérale-libertarienne : telle est la perspective qu’il faut refuser. Eric Sadin appelle à l’insurrection contre un système qui détruit toute civilisation. Il milite pour le refus radical des objets connectés, des assistants numériques, de la généralisation des tablettes numériques à l’école… par la mobilisation de tous les moyens qu’offre le droit. Il faut aussi que l’Etat cesse d’encourager le nihilisme technologique et la marchandisation de l’ensemble de la vie et engage le combat contre les grandes compagnies qui favorisent la domination du capitalisme californien. Contre un modèle radicalement antipolitique, le recours au politique s’impose. Mais qui en voit, aujourd’hui, la nécessité ?
Bertrand Renouvin (Le blog de Bertrand Renouvin, 18 février 2018)
Notes :
(1) Eric Sadin, La silicolonisation du monde, L’irrésistible expansion du libéralisme numérique, Editions L’Echappée, 2016.
(2) Eric Sadin, La vie algorithmique, Critique de la raison numérique, L’Echappée, 2015. Voir ma présentation dans le numéro 1098 de « Royaliste ».
(3) Cf. Lucien Sfez, La santé parfaite, critique d’une nouvelle utopie, Le Seuil, 1995. Présentation dans le numéro 782 de « Royaliste » (2001).
(4) Pour Lucien Sfez, l’utopie repose sur le principe de non-contradiction et travaille dans l’imaginaire, alors que l’idéologie opère dans le symbolique et déploie une dialectique.